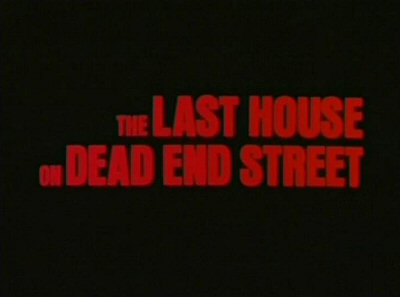Après un séjour en prison pour détention de drogue, un réalisateur de pornos décide de laisser exploser sa haine du monde en mettant en scène des actes de torture avec une bande de complices tarés en guise de techniciens et d'assistants.

On vous avait déjà parlé de ce sulfureux LAST HOUSE ON DEAD END STREET à l'occasion de sa disponibilité via un DVD américain. Sa sortie française nous incite à revenir sur cet étrange objet dont on a du mal à discerner s'il s'agit bien de cinéma ou d'un long trip mégalomaniaque étourdissant de déphasage. Difficile de parler objectivement du film en omettant ses antécédents de film maudit. Pour résumer, le film fut tourné en 1973 par un jeune passionné se fantasmant nouveau chef de file d'un cinéma radical et cérébral, un certain Roger Watkins. Producteur, auteur mais aussi comédien principal, Watkins s'imagine dans la peau du metteur en scène «absolu» qui va repousser les ultimes limites que les années 70 s'efforçaient déjà de reculer. Dans la ligne de mire, ORANGE MECANIQUE de Stanley Kubrick que Watkins veut dépasser en terme d'intensité. Mais la dure réalité de l'exploitation cinématographique s'occupera de replacer l'ego du personnage à sa place. Bloqué pendant quatre années suite à un procès avec l'une des comédiennes, remonté et retitré à foison par le distributeur qui décidera in fine de le faire passer pour un clone de LA DERNIERE MAISON SUR LA GAUCHE de Wes Craven, LAST HOUSE ON DEAD END STREET va purement et simplement disparaître du circuit cinématographique dans l'indifférence générale, y compris l'indifférence de son «auteur».

Néanmoins, le film va peu à peu générer une réputation sulfureuse dans les années 80 car personne n'est alors capable de tracer l'historique de la fabrication du film. Ce dernier est signé sous pseudonyme et aucun protagoniste ne semble en réclamer la paternité. Le thème du snuff movie évoqué par le film prend donc une épaisseur d'une irascible efficacité face à cette «chose» non signée circulant sur des cassettes vidéo issues des marchés pirates. Le film va devenir culte pour une poignée de cinéphiles alternatifs, autant pour ce sentiment de curiosité malsaine que pour le challenge de lever les mystères entourant cette «œuvre» n'appartenant à personne. La fin de l'histoire arrive dans les années 2000 où Roger Watkins émerge enfin sur internet pour reprendre possession de ses crédits d'auteur et de metteur en scène. Suite à l'échec aussi bien commercial qu'artistique de LAST HOUSE ON DEAD END STREET, l'homme avait purement et simplement tourné la page et réalisait des pornos.

Visionner LAST HOUSE ON DEAD END STREET débarrassé de sa «légende» est désormais une expérience particulière. D'un point de vue purement cinématographique, le film est très mauvais. La narration est en roue libre (certes, le distributeur y a prodigué des coupes), le rythme est souvent apathique, le jeu des acteurs absolument grossier, la post-synchronisation des dialogues est pathétique et le tout ne prodigue aucune sorte de début de réflexion alors que le sujet tendait pourtant plusieurs perches. Nous sommes dans l'amateurisme le plus total. Une bande stupide fagotée par des gens sans talent. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, LAST HOUSE ON DEAD END STREET dégage «quelque chose». Quelque chose de noir, de malsain. Quelque chose qui semble venir directement du personnage de Watkins et de la mise en abîme qu'il opère en interprétant en quelque sorte son propre personnage. Ce portrait de metteur en scène sans talent, prêt à tout pour marquer le cinéma de son empreinte, respire la haine et le fantasme de toute puissance. Inconsciemment, Watkins crée un parallèle très intéressant entre une équipe de cinéma et une secte, en l'occurrence une secte marchant sur les plates bandes d'un groupe style Charles Manson.

Le but avoué et (sur)proclamé de LAST HOUSE ON DEAD END STREET est de choquer le spectateur. Le film enchaîne alors les scenettes trash allant de l'énucléation à la perçeuse à la torture au fer rouge, en passant par une séance de fouet sur une jeune femme au visage maquillé comme les comédiens de music hall qui incarnait les caricatures d'hommes noirs. Le clou du film, la cerise sur l'ordure, est une séance de démembrement sur une victime vivante. Une scène qui préfigure les fascinations trash et voyeuristes qui exploseront une quinzaine d'années plus tard avec l'un des volets de la série japonaise des GUINEA PIG. Efficace à l'époque, cette séquence est malheureusement bien dépassée, la faute à des effets spéciaux médiocres et une mise en scène bourrine. Le détail sadique du réveil de la victime par ses bourreaux constatant que cette dernière s'est évanouie sous la douleur fait pourtant froid dans le dos.

L'ambiance poisseuse de LAST HOUSE ON DEAD END STREET ne repose donc pas sur ses scènes gores qui ne marchent pas, ou plus. Elle est plutôt alimentée par une ambiance d'hystérie attisée par Watkins et sa bande dont le comportement (on n'ose pas parler de «jeu» d'acteur) est fortement conditionné par les drogues que l'équipe consommait allègrement sur le plateau de tournage. Avançant sans scénario, Watkins improvisait le film au jour le jour, quitte à se confondre avec son homologue de fiction. Cette ambiance de «mauvais trip» agglomère tous les défauts du métrage, à commencer par les défauts techniques, pour renforcer l'inconfort provoqué par le film. Ce dernier devient comme une sorte de «making-of» d'un tournage halluciné exécuté par des gens transis dans leurs fascinations extrêmes, avançant littéralement «masqués» sur le chemin tortueux de la morbidité. Jusqu'à aboutir à une «vraie» scène choc, une scène de crudité absolue lorsque l'une des sbires féminine du «gourou» oblige une victime homme à lui faire une fellation sur un pénis simulé par une patte de biche. Une idée crasse et vulgaire qui nous hante en premier lieu après le générique de fin.

N'espérez pas découvrir LAST HOUSE ON DEAD END STREET dans des conditions techniques dignes d'un support numérique. Les 30 ans d'invisibilité du film se sentent sur la qualité de la copie qui est, à l'instar de ses homologues étrangers, purement exécrable. Rayures, poussières, voilures, instabilité, scratch de son, souffle permanent, changement de master (style VHS de dizième génération) pendant la scène d'éventration… Difficile de faire pire. Mais, encore une fois, la médiocrité de la copie ne fait que renforcer l'impact du film, son côté crapoteux, son côté vieux film documentaire. Le film est techniquement dégueulasse, et c'est justement parfait comme ça.

La section bonus est bien chargée puisqu'elle reprend la plupart des suppléments du double DVD américain en les sous-titrant en français. Commençons par le commentaire audio de Roger Watkins accompagné de Chas Balun, un journaliste comptant parmi les premiers fans du film. Devant le film, Watkins a quelque peu ravalé sa fierté même s'il se plaint régulièrement des différentes coupes opérées par le distributeur. L'homme s'extasie parfois sur des plans à la composition médiocre, citant même Stanley Kubrick au détour d'une image. Heureusement, Balun est là pour détendre l'atmosphère et remettre le film à sa place : une bobine d'exploitation au parcours atypique. L'ensemble se poursuit donc dans la bonne humeur et la légèreté, créant une étrange distance supplémentaire avec les images du film.

Des bonus audio, il y en aura d'autres car l'édition nous propose un long entretien entre Watkins et son acolyte/comédien Ken Fisher pour le compte d'une radio locale, mais aussi un journal «intime» du tournage de LAST HOUSE ON DEAD END STREET sous forme d'enregistrement de conversations téléphoniques. Cumulant deux bonnes heures d'écoute laborieuse, ces deux bonus nous dressent en creux le portrait de Watkins à l'époque : un chien fou persuadé de son talent (il parle de présenter son film au Festival de Cannes) mais ne dégageant qu'un sentiment indisposant de paranoïa.

Sur le modèle des chutes de montage du DVD de EVIL DEAD proposant des images ou des prises inédites, LAST HOUSE ON DEAD END STREET nous gratifie des fonds de poubelle de la salle de montage sur une vingtaine de minutes de prises écartées. Les images n'ont absolument aucun intérêt et se concentrent sur des séquences de remplissage (comme lorsque Watkins marche dans la neige au début du film). Autre «trésor» historique, nous trouvons des séquences alternatives d'une version antérieure du film, à l'époque où celui-ci s'appelait THE FUN HOUSE. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent non plus, car ces séquences se contentent de nous présenter le générique de début et de fin légèrement modifiés. Dernier vestige lié au film, son étrange bande-annonce n'ayant aucun lien avec le métrage et qui s'amuse à plagier la tagline de LA DERNIERE MAISON SUR LA GAUCHE en mettant en scène un ersatz de la petite fille de L'EXORCISTE.

Toujours repris de l'édition américaine, quatre courts-métrages de jeunesse de Watkins nous sont offerts avec un commentaire audio du metteur en scène. Nous ne pourrons pas visionner les films sans les propos de Watkins pour la simple et bonne raison que ces derniers sont muets par nature ou parce que le cinéaste en herbe avait utilisé de la musique copyrightée sans en avoir les droits. Que ce soit le petit film réalisé à ses douze ans ou bien le court tourné à la fin de ses études, force est de constater que le résultat est uniformément nul et pénible à regarder. Ce qui n'empêche pas Watkins de s'extasier sur l'un ou de descendre un autre via un jugement de valeur qui laisse perplexe.

Dernier bonus de ce copieux disque, et pas des moindres puisqu'il est exclusif au disque français, un petit documentaire sur le film donnant successivement la parole au réalisateur Frank Henenlotter (BASKET CASE) et aux journalistes Romain Le Vern et Frédéric Thibaut. Tandis qu'Henenlotter nous parle du film en se remémorant sa découverte dans un cinéma New-yorkais mal famé, les journalistes font le lien avec la carrière maudite du métrage et sa résurrection surréaliste. Une excellente synthèse du cas LAST HOUSE ON DEAD END STREET, à visionner en priorité.