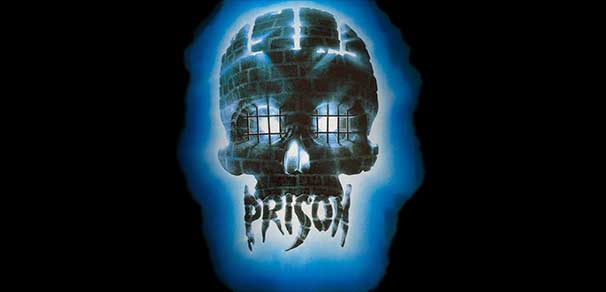Plutôt que de construire une nouvelle prison, il est décidé de rouvrir un pénitencier fermé depuis une vingtaine d’années. Pour remettre en fonction l’établissement, on compte sur le travail des premiers prisonniers qui arriveront dans les lieux. Il ne faut pas longtemps avant que des événements étranges se produisent dans ce film réalisé par Renny Harlin à la fin des années 80.
PRISON est un peu le vestige d’une époque où la série B ressemblait aux films produits pour le cinéma. Mais c’est aussi un film qui coïncide avec la chute de cette industrie prolifique. L’arrivée massive de la vidéo au milieu des années 80, ainsi que la démultiplication des chaînes de télévision, vient clouer le cercueil des petites productions destinées aux salles de cinéma. La censure dans certains pays ferme aussi les possibilités de distribution. Les mastodontes du cinéma d’exploitation que sont les Etats-Unis et l’Italie s’écroulent à cette période. La reconversion vers le marché de la vidéo et de la télévision n’offre pas les mêmes budgets, sans compter que les grands studios se sont mis aussi à l’horreur au milieu des années 70. Il résulte de cette situation une baisse de la qualité visuelle. Ce qui était du Cinéma ressemble de plus en plus à de la Télévision. En cela, PRISON est un chant du cygne pour le genre mais aussi pour Empire, la bien trop ambitieuse maison de production de Charles Band.

PRISON est produit par Irwin Yablans, l’un des artisans du succès de HALLOWEEN de John Carpenter. L’idée d’origine était de réaliser un slasher au sein d’une prison. Le concept semble peu crédible mais l’idée d’un film d’horreur dans l’univers carcéral est engageante. Le scénariste C. Courtney Joyner amène l’idée d’une entité vengeresse qui s’affranchit facilement des murs et des barreaux. Le décor d’une prison n’est pas si simple à mettre en place pour une production aux moyens limités. Fermé en 1981, le Wyoming State Penitentiary de Rawlins était alors à l’abandon. La production s’arrange avec les autorités pour y tourner le film. Mais le lieu ne s’accorde pas complètement avec les exigences du scénario. Ainsi, l’équipe va casser l’un des murs du bâtiment de façon à construire une imposante porte. De même, le pénitencier est équipé d’une chambre à gaz. Cette pièce particulière est réaménagée pour y installer une chaise électrique factice. Et pour peupler l’endroit, il est nécessaire d’avoir une figuration assez importante. On va piocher dans la population locale composée d’anciens gardiens de prison mais aussi des prisonniers d’un établissement voisin ! Des films avaient déjà été tournés au sein de véritables pénitenciers comme LE PRISONNIER D’ALCATRAZ ou L’EVADE D’ALCATRAZ. Et même avec de véritable prisonniers comme pour LES REVOLTES DE LA CELLULE 11 de Don Siegel, tourné en 1954 à l’intérieur des murs de la prison de Folsom. Parmi les véritables prisonniers de PRISON, il y avait Stephen E. Little, cascadeur et acteur de complément, qui purgeait une peine pour homicide. Etant à jour de sa cotisation du Syndicat des Acteurs (SAG), il obtient le rôle de «Rhino». Sans cela, il ne lui aurait pas été possible de donner la réplique aux autres comédiens.

PRISON embarque aussi un grand nombre de comédiens aux têtes connues comme Chelsea Field, Tom Everett, Lincoln Kilpatrick, Arlen Dean Snyder, Tom 'Tiny' Lister Jr. et Lane Smith. Ce dernier incarne avec brio un directeur de prison sadique et tourmenté. Le film met aussi en vedette un jeune acteur qui deviendra très connu par la suite : Viggo Mortensen. Pour autant, ce n’était pas gagné pour lui puisqu’il était en concurrence avec plus de 80 acteurs au moment du casting. Et si pendant un temps, c’est Thom Matthews qui était pressenti, c’est le jeu minimaliste de Viggo Mortensen qui a séduit. Enfin, on notera qu’on trouve déjà au générique Kane Hodden, cascadeur qui deviendra plus tard l’une des incarnations du Jason des VENDREDI 13. Mais s’il y a des cascadeurs sur le tournage, Viggo Mortensen fera en sorte de réaliser lui-même la plupart des scènes physiques.
Derrière la caméra, un jeune finlandais faisait ses débuts aux Etats-Unis. Avec PRISON, Renny Harlin a découvert les plateaux américains et cette expérience lui permit de réaliser ensuite LE CAUCHEMAR DE FREDDY et, de fil en aiguille, il devint l’un des réalisateurs en vue du cinéma d’action des années 90 (58 MINUTES POUR VIVRE, CLIFFHANGER…) avant de sombrer. Si le film fut bénéfique pour Renny Harlin, on ne peut pas dire qu’il en soit de même pour Empire. Au moment du tournage, la maison de production de Charles Band perd énormément d’argent avec la très longue et coûteuse post-production de ROBOT JOX, au point qu’Empire fait faillite. PRISON sera alors très mal distribué et ne rentrera pas dans ses frais…

Comme déjà dit en préambule, PRISON a vraiment une facture cinéma. S’il s’agit d’un petit budget, le film tire grandement partie de ses décors et de la figuration. Plusieurs scènes horrifiques sont mémorables également. Le maquilleur John Carl Buechler propose quelques morts violentes et gores très réussies, dont celle qui se déroule dans des cellules transformées en fournaises. PRISON est ainsi bourré de qualités mais le déroulement de l’intrigue s’avère peu cohérent. La vengeance d’outre-tombe commence par frapper des innocents de manière très aléatoire. Et il faut attendre le climax final pour que l’entité surnaturelle s’attaque réellement à son «bourreau». De même, la séquence d’ouverture d’un passage vers la chambre d’exécution a des airs de POLTERGEIST, oscillant entre réussite et ridicule. Enfin, le personnage féminin interprété par Chelsea Field s’insère de manière peu naturelle dans le récit.
Même si PRISON a été mal distribué à l’époque, il n’était pas sans intérêt. A sa suite, plusieurs films d’horreur ont réutilisé la chaise électrique comme vecteur de vengeance. Ainsi, entre 1988 et 1989, on a pu voir DESTROYER, THE HORROR SHOW et surtout SHOCKER. De fait, le film de Renny Harlin a ainsi eu une certaine influence sur la production cinématographique. Aujourd’hui PRISON, malgré ses gros défauts, est une petite série B plutôt bien troussée et qui prend sa place dans la chronologie de la série B américaine.