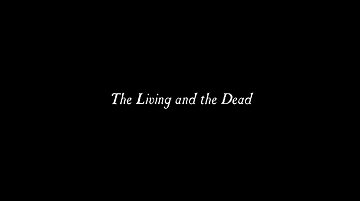À l'origine de quelques courts métrages et de trois films (STRONG LANGUAGE, 2000 ; THE TRUTH GAME, 2001 ; CLUB LE MONDE, 2002) dont l'originalité enthousiasma ceux qui les découvrirent, le britannique Simon Rumley nous offre en 2006 une œuvre intitulée THE LIVING AND THE DEAD. Profondément touché par le décès de sa mère, le cinéaste s'inspire de l'agonie de cette dernière pour explorer les sentiments contradictoires que l'être aimé peut susciter lorsqu'il s'apprête à disparaître. Ému par le récit, Nick O'Hagan accepte de produire cette fiction tandis que les talentueux Roger Lloyd-Pack, Leo Bill (GOSFORD PARK, 2001, Robert Altman ; 28 JOURS PLUS TARD, 2002, Danny Boyle) et Kate Fahy consentent à s'immerger dans les sombres abîmes de la folie.

Donald Brockleban (Roger Lloyd-Pack) passe ses journées dans un manoir en compagnie de son épouse mourante (Kate Fahy) et de son fils malade mental (Leo Bill). Celui-ci profite de l'absence du paternel pour prouver à sa génitrice qu'il est capable de prendre soin d'elle. La situation dégénère rapidement...

THE LIVING AND THE DEAD convoque un certain nombre de thèmes vulgarisés par la littérature du XIXème siècle. Le réalisateur souhaite en effet dépeindre la dégénérescence tant effective que symbolique d'une classe sociale qui, pour beaucoup, n'existe plus à notre époque. Ultimes représentants d'une petite noblesse moribonde, notre famille préserve sa spécificité en s'isolant d'une société dont les principes éthiques, évolutions et modes de fonctionnement ne lui correspondent pas. Apparenté à un refuge, l'immense manoir qui tiendra lieu de seul décor suggère la solitude de personnages emprisonnés dans un espace que l'on croirait illimité. La nudité des murs, le dépouillement des pièces, la sinuosité des escaliers ou au contraire les maints couloirs horizontaux illustrent toute la stérilité d'une existence apparemment exempte de joie. En premier lieu classique, la mise en scène sous-tend une atmosphère particulièrement glaciale. Parfaitement équilibrées, les scènes d'action ou dialoguées conduisent souvent à des confrontations dont les silences s'avèrent pareillement révélateurs. Ajouté à une musique mélancolique, à une lumière bleutée et à des clairs-obscurs très réussis, le jeu tout en retenu des comédiens nourrit l'ambiance volontairement pesante du métrage. Reclus, nos héros évoluent donc dans une espèce de no man's land, allégorie spatiale de leur inéluctable décrépitude. La pourriture gangrène boiseries et papiers peints tandis que de multiples détritus entravent le cheminement du patriarche. Reflet du cadre référentiel, les corps accusent une déchéance équivalente, entre autres mise en exergue par la maladie.

À l'image des archétypes fin-de-siècle plébiscités par Jean Lorrain, Huysmans ou bien Villiers de L'Isle-Adam, les êtres croqués ici présentent des tares régulièrement attribuées aux rejetons d'une lignée agonisante. L'hypersensibilité du père, le cancer de la mère et la débilité du fils ; tels sont les maux qui définissent les grandes figures du fantastique décadent. Néanmoins, contrairement à ses prédécesseurs, Simon Rumley choisit d'envisager les dites déviances avec un réalisme somme toute déconcertant. Des draps souillés d'excréments, des flaques de vomi, les hurlements du déséquilibré ou le rictus du père découragé achèvent d'évacuer la dimension allégorique de cette “chute” pour nous faire ressentir ses conséquences au quotidien. Cafardeux, l'état des lieux acquière une portée supplémentaire lorsque le dernier né projette de soigner sa mère sans recourir au savoir-faire de l'infirmière pourtant prévue à cet effet. La description naturaliste d'un groupe humain vivant en autarcie fixe la base scénaristique d'un étouffant huis clos au sein duquel toutes les passions et frustrations de nos protagonistes s'exacerberont jusqu'à l'issue fatale...

Ainsi, James désire se rapprocher de sa maman, quitte à poursuivre la pauvre dame dans les méandres de la bâtisse. Quelques travellings et contre-plongées rendent compte de la folie du tortionnaire en maintenant une tension fort angoissante. Cette course-poursuite œdipienne admet de beaux moments de pure terreur pour peu que lon adhère au postulat peut-être excessivement auteurisant du cinéaste. De même, la relation (toujours?) conflictuelle avec le géniteur explique le déchaînement d'une violence encline à octroyer aux mots l'impact d'un coup de couteau. Castration d'un héritier désespéré de ne pouvoir s'affirmer; le film de Simon Rumley élargira cette première et trop classique problématique à celle chargée de dénoncer la dépendance du monde occidental au paradis artificiels offerts par la médecine. Comme la pauvre Sara (REQUIEM FOR A DREAM, 2000, Darren Aronofsky), James abuse des médicaments jusqu'à sombrer dans la démence. À l'origine fragile, la frontière entre le rêve et la réalité s'effondre pour plonger le malheureux drogué dans un cauchemar sans fin. Dynamisée par un montage accéléré, une succession de scènes hallucinées transcrivent enfin la progression de la folie qui, meurtrière, révèle d'abord l'énorme souffrance de l'aliéné. Vaine parade au désespoir qui ronge l'Homme contemporain, l'automédicamentation s'apparentera à un suicide général, celui d'une classe sociale exsangue, d'un monde en perdition, d'un mal aimé.

Nouveau venu sur le marché vidéo, l'éditeur Emylia permet de visionner THE LIVING AND THE DEAD dans d'excellentes conditions. En 1.77 avec un transfert 16/9ème, l'image admet une bonne définition ainsi qu'un encodage correct afin de rendre finement le grain d'origine et, de ce fait, l'ambiance glauque. Pêchue et efficace, la bande son anglaise en 5.1 rend particulièrement hommage à la très belle musique du métrage. Dotée de spécificités équivalentes, son homologue française pourrait horripiler certains au regard d'une interprétation calamiteuse. Avare en bonus, le DVD agrémente le film de scènes coupées somme toute dispensables. Dommage.