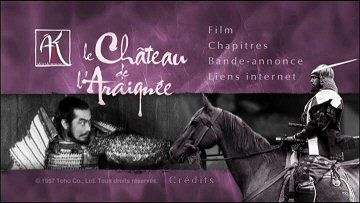Afin qu'ils soient récompensé pour leurs exploits guerriers, Washizu et Miki sont convoqués au château de l'araignée où trône leur actuel suzerain. Lors de leur voyage, les deux amis se perdent en route et rencontrent alors une étrange sorcière qui leur prédira l'avenir : Washizu prendra le commandement de la baronnerie du nord avant de devenir seigneur du château de l'araignée et le fils de Miki sera lui aussi, à terme, amené à prendre le contrôle du fameux château. Particulièrement sceptiques, les deux valeureux guerriers parviennent finalement jusqu'à leur Maître qui, effectivement, leur offre une première promotion… Dès lors, Washizu et son épouse n'auront de cesse de vouloir forcer le destin afin de parvenir enfin jusqu'au commandement suprême…

Le jidai-geki (film historique) est un genre moribond au sein de l'industrie cinématographique nippone d'après guerre. En 1950, Akira Kurosawa entreprend cependant de lui redonner ses lettres de noblesse avec RASHŌMON. L'œuvre franchira les frontières et remportera en 1951 le Lion d'Or à Venise ainsi que l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le réalisateur accède alors à une renommée internationale bien légitime et livre en 1954 un second métrage en costumes : LES SEPT SAMOURAIS. Si le spectateur occidental pouvait encore rester dubitatif face au caractère pour le moins «mystique» de RASHŌMON, il ne peut en revanche qu'applaudir l'incroyable maîtrise dont Kurosawa fait preuve avec cette nouvelle œuvre. Le plus gros budget japonais de l'époque entre alors dans la légende du cinéma et sera donc projeté de par le monde, dans une version toutefois largement tronquée… En 1957, Akira Kurosawa brisera davantage encore les barrières culturelles entre orient et occident en décidant d'adapter Shakespeare à l'écran. Cela donnera LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE, métrage puisant son propos au cœur du MacBeth du dramaturge britannique…

La passion d'Akira Kurosawa pour la culture occidentale n'a à l'époque rien de nouveau. Dès son plus jeune âge, l'homme aura en effet été nourri du cinéma de John Ford, Fritz Lang, Luis Buñuel, Jean Renoir, Charlie Chaplin et Friedrich Wilhelm Murnau sur les conseils avisés de son frère ainé (Akira avait deux frères et quatre soeurs). Cette ouverture au monde fit sans aucun doute la force et le succès du cinéma de Kurosawa mais elle provoqua aussi le courroux de nombreux critiques nippons. L'homme sera ainsi décrit par les siens, non sans un certain mépris, comme le «plus occidental des réalisateurs japonais». L'adaptation de Dostoïevski en 1951 avec L'IDIOT puis le portage de Gorki pour LES BAS-FONDS (1957) ne sont bien évidemment pas étrangers à ce type de jugement mais il ne s'agit là que d'une vision particulièrement étriquée de l'œuvre de Kurosawa. Profondément blessé, l'homme déclarait lui-même qu'il était japonais, pensait comme un japonais et réalisait ses films dans cet état d'esprit. Bien qu'issu d'un matériau d'origine non-japonais, LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE est la parfaite illustration de ces propos et de l'attachement profond de Kurosawa à sa culture.

Il n'est en effet pas question pour Akira Kurosawa de «porter» ou de «mettre en image» l'œuvre de William Shakespeare. Orson Welles lui-même s'y est essayé en 1948 pour un résultat qui, s'il n'est pas déshonorant, n'a véritablement rien de concluant. Comme il le fera en 1985 pour RAN (en partie inspiré par «Le Roi Lear»), le réalisateur japonais souhaite donc avant tout récupérer les thématiques universelles de l'œuvre de Shakespeare pour les intégrer au sein d'un métrage amoureusement nourri de culture et d'art nippon. Pour cela, Kurosawa décide tout d'abord de situer son récit dans le Japon du XVIème siècle, à une période de guerre civile suffisamment trouble et mouvementée pour voir émerger des personnages tels que MacBeth. Un tel cadre historique permet par ailleurs à Kurosawa d'évoquer intelligemment et de manière voilée les dérives militaro-nationalistes de son pays, lequel ne s'est pas encore remis de ses «élans» anti-américains…

Pour son troisième jidai-geki, le réalisateur souhaite voir les choses en grand et s'inspire ouvertement de l'exigence des fresques historiques d'avant guerre et notamment celles de Kenji Mizoguchi. La reconstitution du Japon féodal se doit donc d'être parfaite à tous points de vue. En plus des costumes et objets divers, Kurosawa ira pour cela jusqu'à faire acheminer du sable noir par camions et supervisera la construction de son château-titre en bois et, chose rare, en trois dimensions. Dès lors, l'homme dispose d'une réelle liberté de mouvement et pourra positionner sa caméra à sa guise, jouant ainsi avec les volumes et les formes angulaires de son édifice. Cette approche géométrique de l'image, c'est au théâtre Nô que l'emprunte Kurosawa. L'art japonais dispose en effet de plusieurs formes théâtrales, dont le Nô qui y trouve sa place en tant que représentant du drame dit «lyrique». Bien que mis à mal à la fin du XIXème siècle, le Nô est aujourd'hui une forme d'art inscrite au patrimoine mondial de L'UNESCO. Sa rigueur formelle est l'une des raisons de cette «distinction» et pour les besoins de son film, Akira Kurosawa s'est efforcé d'en respecter les règles. Nous l'évoquions, l'aspect tridimensionnel du lieu de l'action en est une. La scène d'un théâtre Nô se doit en effet d'opter pour une architecture «standardisée» et rectangulaire pouvant être appréciée depuis différents points de vue, en fonction du rang social du spectateur. Nombreux sont donc les séquences du CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE relevant de l'intimisme et se déroulant au cœur d'un espace clos duquel la caméra (et donc le spectateur de la pièce) est exclue. Les dialogues entre le général Taketori Washizu et son épouse (alter-ego de Lord et Lady MacBeth) sont une parfaite illustration de cette représentation théâtrale à l'écran.

Mais l'implication du Nô dans l'œuvre ne se limite bien évidemment pas aux seules considérations architecturales. Akira Kurosawa met ainsi en scène avec LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE les figures caractéristiques de cette forme de dramaturgie dans laquelle les acteurs se doivent de porter l'un des 138 masques existants actuellement (contre une soixantaine au seizième siècle). Chaque masque «officiel» symbolise un personnage typique du Nô mais aussi une humeur, un état ou même une âme. L'un des personnages «masqués» les plus intéressants du film est bien évidemment celui d'Asaji Washizu, la Lady MacBeth interprétée avec une incroyable justesse par l'actrice Isuzu Yamada. Ce protagoniste clef revêt à l'écran deux facettes bien distinctes : La première lorsqu'elle est l'instigatrice calme et froide des drames à venir et la seconde lorsqu'elle cède finalement à la folie. Dans un premier temps, le visage de l'actrice est impassible, blanc et grimé de manière dite «classique». Nous retrouvons donc la bouche fermée (les mots ne font que faire frémir les lèvres), les yeux mi-clos et les sourcils peints en haut du front qui sont les caractéristiques du «masque de femme» type «Fukai» du Nô. Dans un second temps, Asaji Washizu cède à la folie et opte donc pour une attitude faciale là encore figée mais relevant cette fois-ci du masque «Deigan». Kurosawa conserve les traits caractérisant une démence naissante (yeux et bouche parfaitement horizontaux, sourcils inclinés) en y ajoutant une seconde paire d'improbables sourcils. Il est évident que cette dernière liberté, inexistante dans le Nô, est une manière pour le réalisateur d'accentuer la folie de son personnage qui mène au non-respect de règles ancestrales et élémentaires. Là encore, Kurosawa s'approprie un matériau (une forme d'art issue de son pays) et le fait sien pour nous en livrer une variante universelle bien que subtile…

Le personnage du fantôme (ou sorcière ?), se substituant aux trois sorcières de l'œuvre de Shakespeare, est lui aussi un personnage relevant de l'art théâtral japonais. L'individu, joué par l'actrice Chieko Naniwa, nous apparaît comme un croisement entre un vieillard (la sagesse) et un démon (la supercherie). Son teint est pâle et, là encore, son expression est aussi figée que celle d'un masque… Dans l'œuvre d'origine, le rôle des trois démones était bien évidemment métaphorique et s'imposait comme l'objectivation de l'inconscient de Lord MacBeth. Kurosawa conserve bien évidemment cette symbolique en y ajoutant toutefois une série d'éléments qui lui sont propres. Lors de sa première apparition, l'«esprit» nous est donc présenté comme très calme alors qu'il enroule inlassablement un fil, celui de la vie et du destin. Le spectre symbolise alors la plénitude qui règne dans le coeur d'un Lord MacBeth honorable et fidèle. Lors de sa seconde et dernière apparition, l'entité bascule et devient moqueuse avant de revêtir une tenue de guerrier. Elle apparaît et disparaît de manière frénétique, à l'image du chaos qui trouble alors l'âme du héros… Nous noterons par ailleurs que les deux apparitions de l'esprit seront précédées d'une forte pluie, ce qui n'a rien d'anodin lorsqu'on connaît l'œuvre de Kurosawa. Chez lui, les averses torrentielles sont toujours synonymes d'un fort bouleversement et ce depuis son premier film officiel, LA LEGENDE DU GRAND JUDO (le héros décide d'abandonner le jūjutsu au profit du judo). Cet élément naturel (divin ?), nous le retrouverons bien évidemment dans RASHŌMON mais aussi, et entre autres, dans RHAPSODIE EN AOÛT ou même APRES LA PLUIE, son œuvre posthume mise en scène par Takashi Koizumi… En plus de la pluie, Kurosawa va mettre en scène des oiseaux qui serviront à annoncer l'accomplissement des prédictions de l'«esprit». L'usage de ces oiseaux «prophétiques» découle sans doute des temps anciens durant lesquels l'avenir était lu via leur manière de voler. L'expression «oiseau de mauvaise augure» semble donc ici fort à propos puisque c'est ainsi que le couple MacBeth interprètera à différentes reprises les terrifiants croassements…
Le symbolisme par l'image nous apparaît par conséquent comme le moteur de cet envoûtant CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE. Par l'image, Kurosawa parvient à s'affranchir définitivement du verbe qui semblait pourtant indissociable de l'œuvre de Shakespeare. Les nombreux monologues de Lord MacBeth n'ont dès lors plus de raison d'être et seront systématiquement remplacés par d'étonnantes trouvailles visuelles. Là où l'auteur britannique explicitait le doute de son héros via de longues tirades, le metteur en scène japonais nous dévoile un homme perdu dans la brume, errant à l'écran durant près de deux minutes. De même, le destin d'un individu n'a plus besoin de mots pour être explicité : Le MacBeth de Kurosawa ne fera que décocher de manière confuse une série de flèches vers les cieux. Ces flèches, symboles du destin incertain de l'homme, le rattraperont inexorablement en fin de métrage, alors que la prophétie s'est enfin accomplie. Cette image finale est alors d'autant plus puissante que Kurosawa prend sciemment le parti de ne pas montrer (dans un premier temps) les archers à l'écran. Dès lors, qui cause alors la mort de Taketori Washizu / MacBeth si ce n'est lui-même ?

LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE est donc un film d'images dans lequel le silence et l'exposition parlent autant (voire plus) que les mots. Là encore, il s'agit d'un concept hérité du Nô mais aussi et plus largement de la culture picturale asiatique dans laquelle le vide est aussi important que le non-vide (voir par exemple la récurrence du thème du vide dans les écrits du philosophe chinois Lao-Tseu). Akira Kurosawa use donc du vide en tant qu'«espace inspiré». Ces «blancs», nous les retrouverons à l'écran sous forme de longs silences (évocateurs bien sûr), de mouvements minimalistes (précis, justes et essentiels), ainsi que d'un dépouillement graphique très présent. Ces différents points contribuent à faire du CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE le premier film-tableau de son auteur mais aussi le seul qu'il réalisera en noir et blanc dans ce style. Si l'on reste dans le domaine du jidai-geki, Akira Kurosawa n'aura réalisé que deux autres films-tableaux, KAGEMUSHA et RAN, tous deux au format panoramique (1.85) et en couleur. Ce triptyque en costume (ainsi que RÊVES, le film-tableau ultime de son auteur) sera principalement tourné sur les montagnes de Hakone, au pied du mont Fuji. Un lieu lunaire et bercé d'une brume naturelle quasi-omniprésente qui aura séduit Kurosawa dès 1937 alors qu'il participait à LA SAGA DES VAGABONDS de Iesuke Takizawa. Pour les besoins du CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE, le lieu sera bien évidemment magnifié par Muraki Yoshirô, collaborateur régulier de Kurosawa sur plus de vingt métrages, et Asakazu Nakai, responsable de la photographie indissociable des tableaux cinématographiques du Maître...
Toujours au rang des fidèles, nous citerons Masaru Satô, compositeur sur une dizaine de métrages de Kurosawa et successeur émérite du grand Fumio Hayasaka (lequel décédera en 1955 de la tuberculose). Alors qu'il n'a même pas trente ans, Masaru Satô nous livre pour LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE une partition épurée et bien évidemment nourrie d'influences Nô. Nous retrouvons donc les tambours traditionnels mais aussi la fameuse flûte Nōkan à sept trous pour une ambiance sonore en parfaite adéquation avec le traitement graphique du film.

Impossible enfin d'évoquer Kurosawa et son oeuvre sans consacrer quelques lignes à l'incroyable Toshirô Mifune. Expert en Aïkido et septième Dan de Kendo, l'homme deviendra acteur en 1947 et connaîtra la gloire un an plus tard en interprétant le Yakuza tuberculeux de L'ANGE IVRE. Malgré une petite rixe qui verra leurs chemins se télescoper, Kurosawa et son acteur resteront inséparables et indissociables durant plus de 18 ans. Sur LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE, Mifune relève donc l'incroyable défi d'incarner sous forme Nô la figure ô combien connue et complexe de Lord MacBeth. Pour l'occasion, l'acteur renoue avec le jeu «agité» dont il avait déjà usé en donnant vie au brigand de RASHŌMON. L'interprétation est sans surprise parfaite, et ce, que les séquences soient intimistes (l'acteur seul face à ses démons) ou mouvementées. La seule vision d'un Mifune chevauchant son massif cheval (qui n'a rien d'oriental : Kurosawa aimait les Westerns et les chevaux imposants) avec fureur lors de séquences filmées «à la John Ford» suffit à dévoiler les incroyables facultés, dramatiques mais aussi physiques, du bonhomme...
Bien qu'il nous soit présenté comme fin stratège et fier guerrier dès les premières minutes, le personnage du général Washizu s'avère en réalité psychologiquement faible et particulièrement malléable. Ces traits de caractère permettent bien évidemment à son épouse, figée mais calculatrice, d'imposer par la ruse ses différents choix. En cela, Taketori Washizu / MacBeth n'est qu'un pantin soumis au bon vouloir et aux ambitions de Asaji Washizu / Lady MacBeth. Nul doute que ce sont en partie ces traits de caractères, déjà présents dans les écrits de Shakespeare, qui feront naître chez Kurosawa l'idée d'une mise en image. La thématique de la femme forte et calculatrice, nous la retrouverons de manière récurrente dans la filmographie du monsieur qui déclarait lui-même dans son autobiographie : «Mes femmes ont toutes du caractère». Il faudra cependant attendre RASHŌMON pour admirer pour la première fois une «ébauche» de ce qui sera au final le très subtil personnage de Asaji Washizu…

Pour toutes les raisons précédemment citées et pour bien d'autres encore, il serait très erroné et surtout fort regrettable de ne voir dans LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE qu'une «simple» et énième adaptation des écrits de William Shakespeare. Bien évidemment, le matériau d'origine est indiscutablement présent mais il se voit ici transcendé par un Kurosawa qui ne se contentera à aucun moment de la seule compréhension de l'œuvre. Le réalisateur japonais la fait sienne et injecte dans son film autant de Shakespeare que d'influences nippones pour un résultat très personnel, s'inscrivant de plain-pied dans la logique d'une filmographie quasi-parfaite. Il y a dans ce CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE tant de matière, d'intelligence et de maîtrise que chaque vision pourrait être la première. Plus qu'un film, c'est une invitation à la découverte. Celle de la culture nippone bien évidemment mais aussi celle de Kurosawa lui-même, incroyable perfectionniste disséminant dans son œuvre d'innombrables pistes que le spectateur pourra, à sa convenance, décider de suivre ou pas. Qu'importe en réalité car quelle que soit notre approche, le film saura nous contenter et quelles que soient nos attentes, il saura y répondre…

LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE a fait l'objet de plusieurs éditions DVD sur le sol français. En 2001, c'est Arte Vidéo qui s'y colle et nous propose le film dans une version remasterisée et accompagnée d'une poignée de suppléments. D'une qualité fort appréciable, ce disque sera par ailleurs proposé dans un superbe coffret digipack regroupant six chefs d'oeuvre de Kurosawa. Quelques années plus tard, Wild Side décide d'enrichir sa collection «les introuvables» de dix métrages du Maître. Parmi ceux-ci se trouve bien évidemment LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE que l'on pourra donc s'offrir en édition double DVD collector dès 2006 ou en édition simple l'année suivante. Pour les besoins de cette chronique, nous avons opté pour l'édition Collector, commercialisé par Wild Side, qui se trouve aujourd'hui être la plus pertinente sur le marché hexagonal.
Abordons tout d'abord le cas de la copie qui nous est bien évidemment proposée au ratio 1.33 via un encodage 4/3 et ce même si la jaquette erronée évoque un étrange 16/9ème… Nous avons donc là un ratio proche du 1.37 d'origine mais nous noterons cependant une réelle curiosité : Sur les bords gauche et droit de l'image, deux bandes noires apparaissent et disparaissent de manière très régulière. Le ratio de l'image tombe alors à 1.30 environ sans que l'on comprenne vraiment pourquoi… S'il est probable que ce phénomène reste invisible sur les téléviseurs dits «classiques», nul doute que les possesseurs de téléviseurs 16/9ème ou de projecteurs seront quelque peu perplexes face à ce défaut qui peut, à la longue, devenir pénible… Outre cela, nous noterons que la copie est plutôt belle même si elle n'est bien entendu pas dénuée de défauts. Les quelques rayures ou «scratchs» qui viennent ainsi entacher par instant l'image n'ont rien de dramatiques et s'avéraient davantage présents sur la copie de l'édition Arte. Puisque nous en sommes à comparer les éditions, poursuivons en ajoutant que la copie Wild Side est globalement plus claire que celle d'Arte qui se montrait par instant bien trop sombre. L'image Wild Side semble aussi plus contrastée et plus agréable même si, en de rares instants, un voile flou s'immisce et vient ternir le tableau. Ajoutons pour finir que la copie Wild Side propose plus d'image que son homologue Arte et ce tout autour du cadre. Globalement, la copie Wildside est donc très honorable et supplante celle de la précédente édition…
Sur le plan sonore, nous n'aurons guère de surprise avec l'unique présence de la piste mono japonaise d'origine proposée ici sur deux canaux. L'écoute est claire, propre et agréable. La retranscription des dialogues est parfaite et celle des exotiques instruments du théâtre Nô s'avère très convaincante. Pour simplifier la compréhension d'une œuvre paradoxalement très épurée en terme de dialogues, Wild Side nous propose fort logiquement un sous-titrage français de qualité qu'il sera toutefois impossible de désactiver.

Abordons maintenant le contenu éditorial de cette édition qui se voit réparti sur deux disques. La première galette nous propose au lancement le film-annonce de la collection Wild Side «les Introuvables». La chose peut bien évidemment être zappée pour aboutir directement sur un très joli menu animé. Celui-ci nous invitera à lancer le film mais aussi à découvrir la bande-annonce du métrage, présentée en version originale sous-titrée et s'étalant sur une durée de trois minutes trente environ. Nous déplorerons de n'avoir dans cette section les neuf autres bandes-annonces des films de Kurosawa proposés par l'éditeur… Sur le second disque, nous pourrons découvrir une galerie de douze photographies présentées en basse résolution mais aussi deux documentaires excédant les vingt minutes chacun. Le premier, intitulé «L'influence du théâtre Nô», est d'origine japonaise et donne la parole à de nombreuses personnes ayant été impliquées sur LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE. Kurosawa lui-même sera interviewé et nous livrera quelques sympathiques anecdotes. Si le titre du documentaire semble indiquer un décorticage des influences Nô, il n'en est rien, en réalité, puisque la moitié du temps sera consacrée à Kurosawa et à la production de son métrage. Le document ne manque cependant pas d'intérêt et chacune des apparitions du réalisateur s'avère intéressante quoique malheureusement trop courte. Le documentaire «Dans la toile du Maître», réalisé en 2005 par Wild Side, donne quant à lui la parole à Koichi Hamamura, du département artistique, et Teruyo Nogami, en partie responsable du script. Les propos sont intéressants et nous dévoilent essentiellement l'envers de la production du film de Kurosawa. Les anecdotes vont bon train et là encore, c'est essentiellement le perfectionnisme quasi-maladif du réalisateur qui semble avoir marqué les esprits. Malgré les indiscutables qualités de ces documents, nous regretterons que la parole n'ait pas été donnée à un intervenant spécialisé dans l'œuvre de Kurosawa. Nous aurions peut être pu obtenir quelques «clefs» supplémentaires ouvrant la porte à d'énièmes et passionnantes approches du métrage…

Le second DVD se clôt enfin sur trois filmographies présentées sous formes de très nombreuses pages fixes. Celle de Akira Kurosawa ouvre bien évidemment le bal, suivie de celle de son acteur fétiche Toshirô Mifune. La troisième sera consacrée au grand Takashi Shimura, lui aussi coutumier des œuvres de Kurosawa. Le choix de proposer la filmographie de cet acteur rend sans doute plus hommage à sa passionnante carrière qu'à son rôle dans LE CHÂTEAU DE L'ARAIGNÉE puisque l'homme n'y tient que le rôle très éphémère du Suzerain trahi…